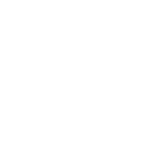Bienvenue dans le catalogue en ligne du centre de documentation conjoint de Smart et de Culture & DĆ©mocratie.
Le catalogue rĆ©pertorie plus de 3000 ressources liĆ©es aux champs dā€™actions thĆ©matiques des deux organisations partenaires, parmi lesquels : sociologie de lā€™art et de la culture, politiques culturelles, mouvement coopĆ©ratif, entrepreneuriat solidaire, Ć©conomie sociale.
Une partie des ressources dite Ā« vive Ā» est directement accessible dans le centre de documentation, une autre partie est archivĆ©e.
Ce fonds documentaire multilingue regroupe des ouvrages scientifiques, des essais, des guides pratiques, des thĆØses, des revues, des dossiers, des publications sur supports numĆ©riques, ā€¦.
Toutes les ressources disponibles dans le centre de documentation sont en consultation libre sur place. Lā€™emprunt nā€™est pas consenti. Photocopieuse disponible sur place pour la reproduction dā€™extraits.
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier Ć©cran avec les derniĆØres notices... |